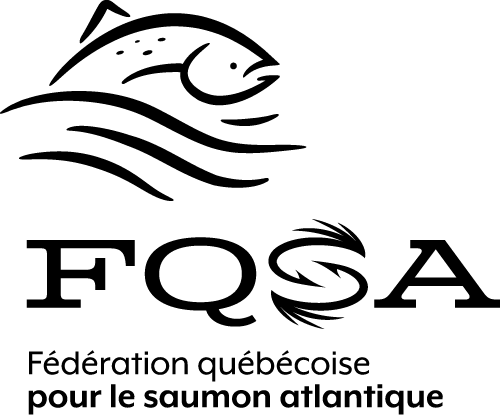Situation préoccupante pour le saumon au Québec
Présenté par la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA)
 Crédit : Hooké
Crédit : Hooké
L’été 2023 a marqué une baisse inquiétante du nombre de jeunes saumons (madeleineaux) dans les rivières du Québec, avec des diminutions allant jusqu’à 90 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Pourtant, le nombre total de saumons observés semblait, à première vue, stable. Ce phénomène a soulevé de nombreuses questions, poussant les experts du MELCCFP à analyser la situation lors d’une rencontre au printemps 2024.
Leur constat : la cohorte de saumoneaux qui a dévalé nos rivières en 2022 a été largement décimée, expliquant ainsi le faible retour de madeleineaux.
Grâce aux longues séries temporelles de données de montaison sur nos rivières témoin, une forte corrélation a été établie entre les montaisons de madeleineaux une année, et les montaisons des dibermarins (saumon ayant passé 2 ans en mer) l’année suivante. Cette corrélation a également été confirmée sur d’autres rivières du Canada et de la Norvège. Il devenait donc assez clair que 2024 serait une année difficile pour les montaisons de grands saumons. Face à cette situation, et pour tenter
d’atténuer ces impacts, les modalités de pêche ont été ajustées avant le début de la saison, puis modifiées à nouveau en cours d’été.
Sans surprise, l’été 2024 a confirmé ces craintes : on observe les plus faibles remontées de grands saumons depuis 1984, avec des baisses variant de 20 % à 80 % selon les rivières. De plus, le retour des madeleineaux est encore une fois très faible.
À quoi s’attendre pour 2025? Malheureusement, ça n’augure rien de bon pour les grands saumons l’été prochain. Quant aux madeleineaux, il est impossible de prévoir leur retour, ce qui ajoute une part d’incertitude à la situation. Le MELCCFP a pour sa part annoncé les modalités de pêche pour la saison 2025 le 13 mars dernier, et celles-ci sont conformes aux recommandations de la FQSA. La remise à l’eau de tous les saumons sera obligatoire sur la quasitotalité des rivières du Québec méridional, à l’exception des rivières de basse Côte-Nord où un madeleineau pourra être conservé. Dans les circonstances actuelles, des modalités de pêche basées sur une approche de prudence étaient requises.
Une rencontre cruciale pour l’avenir du saumon
Le 21 février 2025, à Québec, une rencontre déterminante de la Table technique saumon a été organisée, à la demande de la FQSA, pour discuter de l’enjeu de la mortalité en mer. Coordonnée par le MELCCFP, cette rencontre a réuni des experts de divers secteurs, dont la FQSA, Pêches et Océans Canada, et plusieurs autres partenaires, afin d'analyser les défis actuels et d'élaborer des actions concrètes pour les mois à venir.
La discussion a porté sur quatre grands thèmes: les problématiques liées à l’interception dans les pêcheries commerciales au hareng et au capelan, l'examen des impacts des changements océanographiques, des risques liés à la propagation de maladies par des saumons d'élevage et du rôle du milieu dulcicole (en eau douce) sur la survie des saumoneaux.
Dans ce dossier spécial, nous vous présenterons en détail chacune de ces hypothèses, en expliquant les enjeux soulevés et les pistes de réflexion qui guideront les décisions à venir.
Des hypothèses écartées, mais un mystère demeure

1. L’hypothèse d’une faible production de saumoneaux a été invalidée grâce aux suivis de dévalaison, qui ont confirmé un nombre normal de jeunes quittant nos rivières.
2. L’idée que les madeleineaux aient simplement retardé leur retour en rivière pour revenir en grands saumons a aussi été contredite par les données : les remontées de grands saumons en 2024 sont exceptionnellement faibles.
3. Les pêches commerciales au Groenland, souvent pointées du doigt, ne semblent pas être en cause non plus. Le suivi rigoureux des quotas et la baisse du nombre de saumons prélevés ne correspondent pas à une chute aussi drastique des populations.
4. Enfin, le bar rayé, un prédateur naturel du saumoneau, n’a pas pu causer un impact aussi généralisé sur toutes les rivières du Québec. De plus, le bar rayé est présent depuis plusieurs années, alors que le phénomène de mortalité massive de saumoneaux n’est survenu qu’en 2022 et 2023.
Hypothèse #1 : L'interception de saumoneaux dans le cadre de pêcheries commerciales
Une partie très importante de la mortalité en mer se produit au début de la migration, au moment où tous les saumoneaux sont encore ensemble avant de se séparer en deux groupes : ceux qui sont destinés à revenir sous forme de madeleineaux (grilse) l’année suivante, qui resteront près des côtes canadiennes, et ceux étant destinés à revenir sous forme de grand saumon, 2 ans plus tard, qui feront une migration complète jusqu’au Groenland.
 Crédit: FQSA
Crédit: FQSA
Alors que les conditions en rivière sont restées relativement stables, les analyses indiquent que cette mortalité surviendrait principalement aux abords du détroit de Belle Isle, une zone clé de migration pour les jeunes saumons.
Un point d’attention particulier concerne la présence d’une pêche commerciale au capelan et au hareng dans ce secteur, précisément lors du passage des saumoneaux. Bien que des analyses supplémentaires soient nécessaires pour établir un lien direct, cette coïncidence temporelle soulève des questions sur l’impact potentiel de ces activités sur la survie des jeunes saumons.
Les observations sur la pêche au hareng montrent qu'il y a des chevauchements importants avec le passage des saumoneaux dans les zones de pêche. Les données démontrent un effort de pêche plus marqué dans les dernières années, ce qui pourrait entraîner un risque plus élevé de prises accidentelles. Bien que cela n'explique pas complètement les variations de survie des saumoneaux, il semble que leur changement de migration, influencé par la température des courants, pourrait les diriger vers des zones où se concentre la majorité de la pêche au hareng.
Cette tendance doit être validée avec les modèles de migration pour les années concernées. L'utilisation d'observateurs en mer serait la meilleure manière de confirmer cette hypothèse. Une approche préventive suggère de suspendre la pêche pendant 7 à 10 jours pendant le passage des saumoneaux pour protéger les populations, ce que nous prioriserons dans nos recommandations au fédéral.
Hypothèse #2 : Les changements océanographiques
 Crédit: Matt Hardy
Crédit: Matt Hardy
Parmi les pistes explorées pour expliquer le déclin marqué des jeunes saumons, les changements océanographiques sont envisagés comme un facteur contributif, bien que d’autres hypothèses soient également à l’étude. Selon les experts de Pêches et Océans Canada (MPO Québec), le golfe du SaintLaurent et l’Atlantique Nord ont connu des bouleversements importants ces dernières années. Les tendances au réchauffement se sont poursuivies en 2022 et 2023, avec des records de chaleur enregistrés. Toutefois, des anomalies froides ont également été observées dans certaines zones, ajoutant à la complexité du phénomène.
Ces variations pourraient avoir influencé la migration des saumoneaux, modifié la répartition de leurs proies ou encore amplifié leur exposition aux prédateurs. Bien qu’il soit difficile d’évaluer précisément leur impact, ces changements océanographiques font partie des éléments analysés pour mieux comprendre ce déclin préoccupant.
Hypothèse #3 : Transfert de maladies ou parasites par des saumons d'élevage dans les fermes des provinces maritimes
 Crédit: NOAA
Crédit: NOAA
Deux principales causes possibles de mortalités soudaines et massives chez les saumons sont l’anémie infectieuse et les poux de mer.
Anémie infectieuse :
Ce virus peut se propager jusqu’à environ 5 km des cages de saumons, selon les courants et les marées. Cette maladie est généralement détectée rapidement, ce qui permet de contrôler la propagation en récoltant rapidement les poissons infectés. Bien que des cas aient été observés à Terre-Neuve en 2022, le MPO estime que ce n'est pas la cause principale de la mortalité élevée entre 2022 et 2023.
Poux de mer :
Bien que cette cause soit envisageable, elle semble moins probable dans notre région en raison de notre situation géographique. Les fermes de saumon d’élevage y sont relativement éloignées des zones de migration des saumoneaux, du moins pour ceux du Québec. Ce n'est pas le cas en Norvège, où la situation est plus problématique, car les fermes sont situées directement sur le parcours migratoire des saumons sauvages.
Cependant, certains experts suggèrent que le virus de l’anémie infectieuse pourrait affecter les smolts qui passent près des fermes de Terre-Neuve et propager le virus à un grand nombre de smolts, notamment près de Belle Isle. Cela met en évidence l'importance d’évaluer la santé des smolts en migration dans cette zone. Bien que difficile, cette évaluation pourrait être réalisée grâce aux captures accidentelles par les pêches de capelan et de hareng, par exemple.
Hypothèse #4 : L'influence du milieu dulcicole (eau douce / rivières) sur la survie des saumoneaux
 Crédit: Hooké
Crédit: Hooké
Parmi les rivières ayant fait l’objet d’un suivi de dévalaison dans les dernières années (Trinité, St-JeanGaspé, Matapédia et Cascapédia), aucune différence notable dans le nombre de smolts en dévalaison entre 2022 et 2024 n’a été signalée (certaines augmentations ont même été observées). Aucune variation importante n’a été observée dans leur taille et poids. Cependant, une évaluation plus approfondie de leur santé est nécessaire. Il est possible que l'environnement d'eau douce influence leur survie en mer, notamment par la température de l'eau qui impacte leur système immunitaire. De plus, les dévalaisons semblent se produire de plus en plus tôt, ce qui soulève des questions sur les impacts potentiels pour les saumoneaux.
Les recommandations de la FQSA
pour les gouvernements fédéraux et provinciaux
Afin de protéger et de préserver le saumon atlantique, plusieurs mesures sont nécessaires à court, moyen et long terme. Les recommandations suivantes, adressées tant au gouvernement fédéral qu’au gouvernement provincial, visent à renforcer la gestion de la pêche, améliorer la recherche et assurer la conservation de cette espèce clé dans nos écosystèmes. Voici les actions à entreprendre dès maintenant pour soutenir ces efforts.
AU FÉDÉRAL
À court terme :
- Ajouter des observateurs sur les bateaux de pêche au capelan et au hareng pour la saison 2025. La FQSA et l'ASF sont prêtes à collaborer à cet effet.
- Limiter la pêche au capelan et au hareng dans les zones 4SW et 4RA près du détroit de Belle Isle pendant 5 à 10 jours, au moment du passage des saumoneaux, pour la saison 2025. Une ou deux exceptions peuvent être faites pour récolter des smolts.
- Inclure le cycle de vie en mer dans la Stratégie de conservation du saumon atlantique au Canada.
À moyen et long terme :
- Créer une Table saumon pour l’est du Canada.
- Revoir les quotas et les modalités des pêches au capelan et au hareng.
- Financer la recherche pour mieux comprendre la migration des saumoneaux.
- Soutenir les recherches du Plan conjoint de recherche sur le saumon atlantique (PCRSA).
AU PROVINCIAL
À court terme :
- Intensifier la recherche pour identifier les causes de mortalité en mer des saumons.
- Renouveler le financement pour le secteur du saumon.
À moyen et long terme :
- Maintenir la Table technique saumon et continuer à collaborer avec les acteurs de la Table nationale faune (TNF) et les experts d’autres régions.
- Continuer à travailler avec la FQSA (et TNF) pour les décisions sur la pêche.
- Financer et soutenir le Réseau de suivi de température des rivières à saumon (RivTemp).
- Soutenir les recherches sur le saumon atlantique dans les environnements d'eau douce (santé, dévalaison, température, etc.).
Conclusion
En résumé, les actions et recommandations proposées pour la gestion du saumon atlantique, tant au niveau fédéral que provincial, sont essentielles pour la préservation de cette espèce et pour répondre aux défis actuels de sa conservation.
Le suivi des conditions de migration, de dévalaison et de température, ainsi que l’engagement des chercheurs, sont des éléments clés pour renforcer la résilience du saumon face aux changements environnementaux.
Les mesures proposées, telles que l’ajout d’observateurs sur les bateaux de pêche et l’intensification des recherches sur les causes de mortalité en mer, visent à améliorer notre compréhension et la gestion des populations de saumons.
À cet effet, Pêches et Océans Canada (MPO) a annoncé le 13 mars 2025 le lancement de sa stratégie visant à rétablir et reconstituer les populations de saumon atlantique au Canada. Une stratégie que la FQSA, la Fédération du saumon atlantique (FSA) et d’autres organismes attendent depuis fort longtemps. La FQSA et la FSA ont d’ailleurs milité sans relâche pour sa mise en place à l’automne dernier, suivant les montaisons catastrophiques de 2024. Le MPO souligne à plusieurs reprises dans sa stratégie l’importance du saumon atlantique pour les communautés, à quel point sa situation est délicate et combien il est précieux comme espèce emblématique de la qualité de nos eaux. Nous espérons que la somme annoncée au moment du lancement de la stratégie n’est que le début d’un plus vaste programme de financement, qui permettra de soutenir et accentuer la recherche, notamment en milieu océanique. Un tel programme, appuyé par une enveloppe de 647M$, avait été mis sur pied en 2021 pour enrayer les déclins historiques des principaux stocks de saumon du Pacifique. La FQSA et la FSA croient que le saumon atlantique en mérite tout autant.
Pour s’informer davantage et suivre le dossier: www.saumonquebec.com